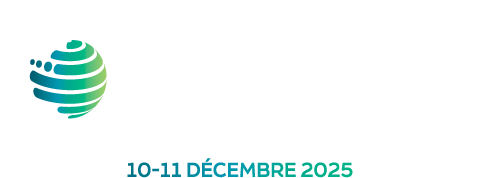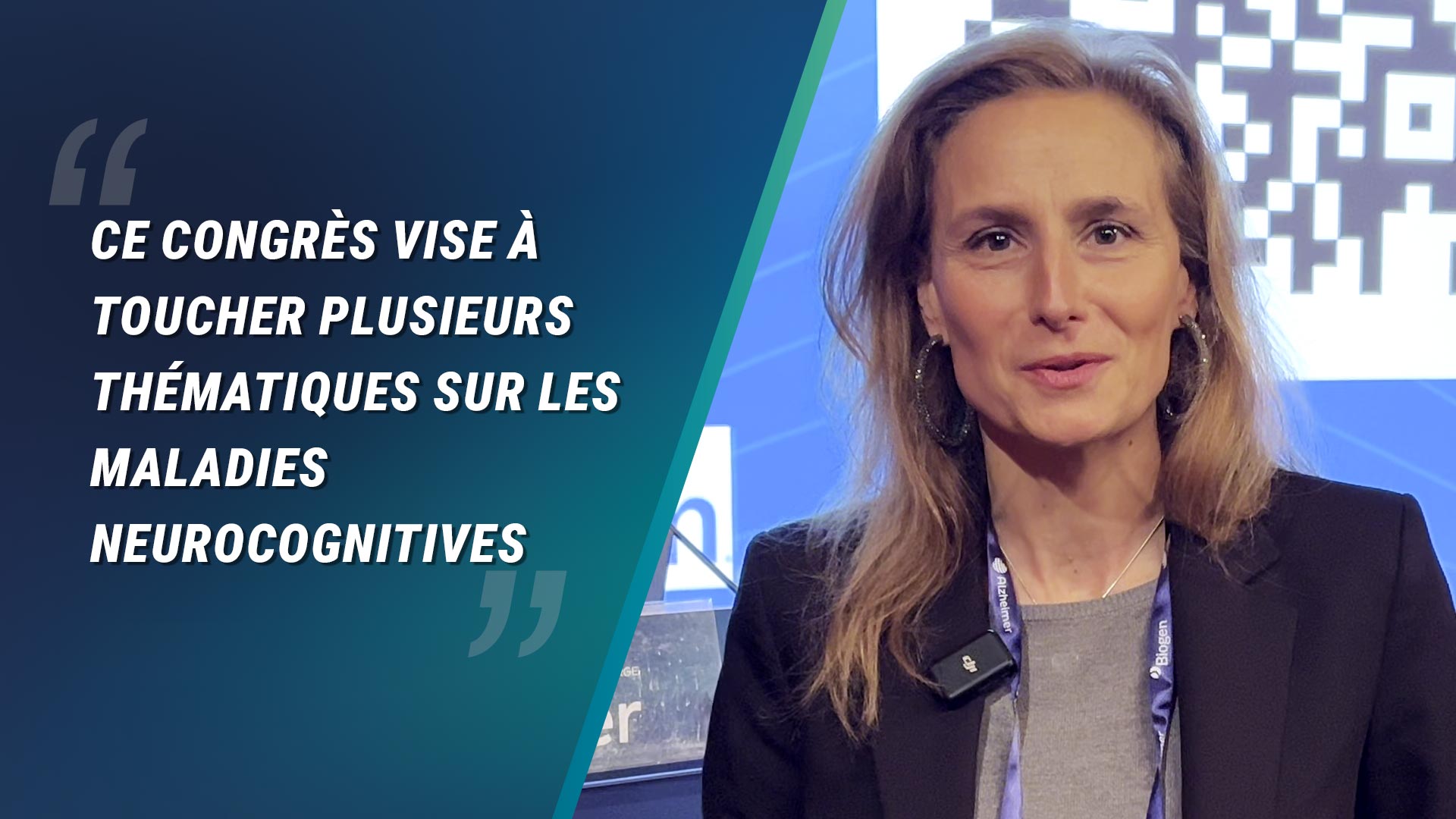Edito du Pr. David Wallon

Vers une médecine de précision contre les maladies neurocognitives
Après une longue période d’apparence silencieuse, marquée par l’attente des patients, des aidants et des soignants, la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies neurocognitives connaît une accélération sans précédent. Cette dynamique transforme notre compréhension des mécanismes pathologiques, tout en faisant émerger des solutions concrètes, diagnostiques et thérapeutiques, qui modifient le paysage du soin.
Les progrès réalisés dans la caractérisation des phases précoces de la maladie, ont rendu possible l’identification de biomarqueurs fiables et reproductibles, aujourd’hui disponibles par ponction lombaire ou imagerie, et demain peut-être par simple prise de sang. De même, l’identification au cours des dernières années de multiples variations génétiques modulant de façon plus ou moins importante le risque de la maladie place la génétique comme une composante majeure. Toutes ces avancées alimentent l’espoir d’une véritable médecine prédictive, capable de cibler les personnes à risque bien avant le retentissement fonctionnel. Elles posent néanmoins des questions d’interprétation, de communication du risque, et d’équité d’accès, qui restent à trancher collectivement.
Sur le plan thérapeutique, l’entrée dans l’ère des traitements modificateurs de la maladie constitue une rupture majeure. Les anticorps dirigés contre le peptide amyloïde parmi lesquels l’un d’entre eux bénéficie depuis avril dernier d’une autorisation européenne de mise sur le marché, changent notre rapport à la notion même de traitement : il ne s’agit plus de limiter les symptômes, mais d’intervenir sur les mécanismes biologiques de la pathologie. La balance bénéfice-risque reste toutefois étroite et la population ciblée très restreinte, imposant une réorganisation de notre système de soins pour l’identification des patients, la gestion des risques, le suivi longitudinal et la coordination entre nos disciplines neurologiques, gériatriques, psychiatriques, radiologiques et même de médecine d’urgence.
La réponse ne peut toutefois pas être uniquement pharmacologique. Les interventions non médicamenteuses comme la stimulation cognitive, l’activité physique adaptée, les interventions psychosociales, restent des piliers complémentaires de la prise en soin. Elles participent à maintenir l’autonomie, à préserver la qualité de vie et à accompagner l’entourage dans des parcours longs et éprouvants.
Enfin, il devient indispensable d’élargir notre regard à l’ensemble des pathologies neurocognitives. La maladie à corps de Lewy, les dégénérescences lobaires frontotemporales, ou l’encéphalopathie limbique à TDP43 liée à l’âge (LATE) plus récemment définie, complexifient nos diagnostics, interrogent nos outils et bouleversent parfois nos représentations cliniques. Leur reconnaissance accrue impose de revisiter nos classifications et de repenser nos stratégies d’évaluation et de soin, en particulier chez les personnes âgées.
Ce congrès réunissant chercheurs, cliniciens et acteurs du soin s’ouvre vers 2026 dans un moment charnière : les repères bougent, les limites techniques reculent, et le champ des possibles s’élargit. Il nous appartient, ensemble, d’en tirer le meilleur pour renforcer une médecine de précision, éthique et adaptée, au service de chaque patient.
Excellent congrès à tous les participants !
Pr. David WALLON
Président de la Fédération des Centres Mémoire
Responsable du Centre Mémoire de Ressource et de Recherche de Rouen
Centre National de Référence Malades Alzheimer Jeunes
Service de Neurologie
CHU-Hôpitaux de Rouen
À voir aussi
Trouble neurocognitif léger ou maladie d’Alzheimer ?
Distinguer un trouble neurocognitif léger de la maladie d’Alzheimer : un enjeu clé du…
Prévenir les complications de la maladie d’Alzheimer
Complications de la maladie Alzheimer : peut-on les prévenir ?
Ouverture du Congrès 2025
Le Congrès National Alzheimer 2025 a officiellement ouvert ses portes ce matin, avec…